Les pages les plus consultées
Le risque radon

Le radon est présent partout : dans l’air, le sol, l’eau. Le risque pour la santé résulte pour l’essentiel de sa présence dans l’air intérieur.
Comprendre le risque radon
Le radon est un gaz radioactif, d’origine naturelle, incolore et inodore. Il fait partie de notre principale exposition d’origine naturelle aux rayonnements et représente, après le tabagisme, la deuxième cause de décès par cancer du poumon.
Dans nos habitations et nos lieux travail, il peut, si des précautions particulières ne sont pas prises, s’accumuler et atteindre des concentrations élevées. Il est indispensable d’évaluer le risque radon dans tout projet de rénovation ou de construction. En cas de présence de radon, des adaptations peuvent s’avérer nécessaires pour garantir la santé des occupants.
Comment en tenir compte ?
Pour aider les occupants de bâtiments existants et les équipes projet qui construisent des bâtiments neufs à évaluer le risque radon, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN) a réalisé une cartographie du potentiel radon à l'échelle communale. En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs zones sont considérées comme étant à risque, parmi lesquelles la Saône et Loire, le Jura ou, bien encore, le Territoire de Belfort.
Cette information doit être corrélée aux caractéristiques du bâtiment et idéalement être complétée par des mesures radon in situ. Les mesures de radon son conseillés même en dehors des zones à risque identifées.
BON À SAVOIR : certaines typologies de bâtiment accueillant un public sensible (écoles, crèches,….) font l’objet d’une réglementation spécifique vis-à-vis du radon.
Une boîte à outils dédiée
En Bourgogne-Franche-Comté, un projet mené par l’Université de Franche-Comté et la HEIEA de Fribourg, en partenarait avec un ensemble de partenaires parmi lesquels l’IRSN, le CEPN, le Cerema, le CSTB, l'ARS, l'ASN, la DREETS, la DREAL, ATMO-BFC ou, bien encore, le Pôle énergie, a permis la création de la plateforme Batisph'air (anciennement Jurad-Bat).
La plateforme Batisph'air met à disposition une boite à outils pour la qualité de l’air intérieur et le radon. Elle propose des informations thématiques et réglementaires ainsi que des travaux et solutions à mettre en œuvre pour le grand public, les professionnels et les collectivités.
Se protéger du radon lors d'une rénovation
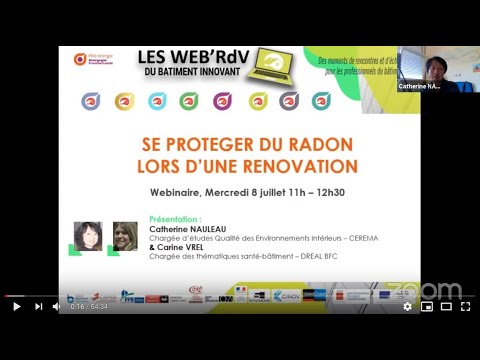
Se protéger du radon lors d'une rénovation - Présentation Web'RDV [VERSION COURTE]
Liens utiles
Dernière mise à jour : 29.08.2023
